Découvrez les ressources et actualités du laboratoire Cerba
article categories
Tous nos articles
-
 Formation2025-12-25
Formation2025-12-25Formation DPC 2025
-
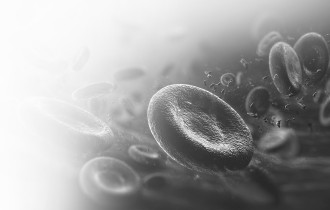 Cerba Live Session2025-12-04
Cerba Live Session2025-12-04[REPLAY] Hémophilie acquise : quand l'immunité s'attaque à la coagulation
-
 Nouvel examen2025-11-28
Nouvel examen2025-11-28Alzheimer : Avancée majeure dans l'orientation diagnostique
-
 Cerba Live Session2025-11-20
Cerba Live Session2025-11-20[REPLAY] Le myélome multiple : quand les biologistes tombent à pic !
-
 Cerba Live Session2025-10-09
Cerba Live Session2025-10-09[REPLAY] VRS, virus respiratoires et grippe : quelles nouveautés pour cette nouvelle saison ?
-
 Podcast2025-10-07
Podcast2025-10-07[PODCAST S7 E3] Échec d'analyse en oncologie : quelles alternatives ?
-
 Podcast2025-09-30
Podcast2025-09-30[PODCAST S7 E2] Alpha-thalassémie : un trouble mineur à l’enjeu majeur
-
 Cerba Live Session2025-09-25
Cerba Live Session2025-09-25[REPLAY] CMV et grossesse : évolution des recommandations, nouvelles pratiques
-
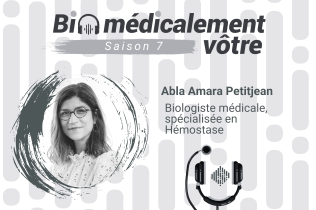 Podcast2025-09-23
Podcast2025-09-23[PODCAST S7 E1] Syndrome de Willebrand acquis : le diagnostic inattendu

